Dates importantes concernant les élections municipales à venir
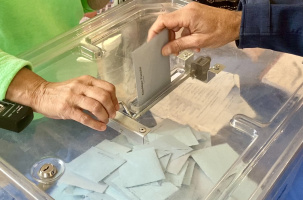
Tout juste revenu de Mayotte, Jean-Pierre Vigier a voulu faire le bilan de son premier séjour sur cette île française, si éloignée des problématiques actuelles de la métropole.
Après un vol de 15 heures, Aurélie Trouvé (LFI), présidente de la commission, ainsi que les vice-présidents Charles Fournier (écologiste et Social), Pascal Lecamp (DEM) et Jean-Pierre Vigier (LR), accompagnés de Cédric Jurgensen, chef de service de la commission, posent enfin le pied sur l’île.
Bien que court et intense, le voyage est rythmé par une succession de rendez-vous et de visites, du mercredi 26 février après-midi au vendredi 28 au matin.
Mayotte, seule île des Comores, française
Mayotte, seule île de l’archipel des Comores à avoir choisi de rester française lors du référendum de 1974 (contesté par l'union des Comores), devient une collectivité départementale en 2001. En 2009, un nouveau référendum confirme cette volonté avec 95,2 % des voix, aboutissant à son statut de 101ᵉ département français en 2011. En 2014, elle intègre l’Union européenne en tant que région ultrapériphérique, bénéficiant ainsi des fonds européens.
Cependant, les quatre îles de l’archipel des Comores sont historiquement et culturellement liées. De nombreuses familles sont partagées entre Mayotte et les autres îles, rendant toute séparation complexe.

Construire un nouvel avenir
« L’un des maître-mot du projet, c’est le défi », explique Jean-Pierre Vigier. Les chiffres sont édifiants :
- Âge moyen de 25 ans
- 80 % de la population vit sous le seuil de pauvreté
- 37 % sont au chômage
- 12 000 naissances par an
La Population officielle est de 320 000 habitants, mais la distribution d’eau potable suggère un chiffre réel entre 400 000 et 450 000 habitants.
Le cyclone Chydo a, malgré lui, braqué les projecteurs sur l’île et les problématiques qu’elle rencontre. À leur arrivée, les élus découvrent un paysage dévasté. Après les mesures d’urgence prises en début d’année, il est désormais temps d’évaluer les dégâts et de définir les actions à mener.
Par où commencer ?
« Ce n’est pas une reconstruction, c’est une construction à mener. » souligne Jean-Pierre Vigier
Les défis sont immenses : eau, électricité, assainissement, éducation, santé…
Actuellement, seulement un quart de la population a accès à l’eau courante distribuée par "tour d’eau", c’est-à-dire par séquences de 36 heures.
Plusieurs solutions sont alors envisagées :
- Construction d’une seconde station de dessalement ;
- Création d’une retenue collinaire pour stocker l’eau de pluie ;
- Mise en place d’un système d’assainissement dans les grandes villes ;
- Organisation d’un système de tri et de gestion des déchets.
En parallèle, l’éducation et la santé doivent être renforcées avec la construction et réhabilitation d’écoles pour scolariser plus d’élèves, la création de CFA (Centres de Formation d’Apprentis) pour développer la formation professionnelle et la construction d’un deuxième hôpital pour améliorer l’accès aux soins (Actuellement l'attente moyenne y est de 24 heures.)

Entre économie et insécurité
Le développement économique est un autre enjeu majeur. Actuellement, l'agriculture répond à 30 % des besoins alimentaires de l’île. Chaque agriculteur dispose en moyenne d’1,5 hectare de terre. L’élevage de poulets de chair et d’œufs est suffisant, mais aucune filière de pêche structurée n’a été mise en place.
L’insécurité est l’un des freins au développement, notamment pour le tourisme. L'immigration incontrôlé entre les Comores et Mayotte alimente une économie parallèle avec une main-d’œuvre à bas coût.
« Pas de formation, pas de personnels qualifiés. »
Les réalités locales sont aux antipodes de celles de la métropole à bien des égards. Les emploi publics bénéficient d’un salaire 40 % plus élevée que ceux du secteur privé et la population attend des actions concrètes de l’État pour améliorer ses conditions de vie.
Les élus présents sur place transmettront un rapport détaillé afin de guider les décisions gouvernementales à venir. De nombreux projets doivent encore voir le jour comme le développement des axes routiers et du port et l’allongement des pistes d’atterrissage de l’aéroport.
« Le préfet fait ce qu’il peut et il fait un excellent travail, mais tout ne peut pas être fait d’un coup. » Jean-Pierre Vigier,
Les premiers chantiers ne débuteront pas avant 2026. Malgré tous ces défis, les Mahorais souhaitent avant tout développer leur île et construire un avenir plus stable et prospère.

Vos commentaires
Se connecter ou s'inscrire pour poster un commentaire
4 commentaires
Personne ne trouve étrange qu'une député LFI, présidente de la commission se soit rendu à Mayotte ; par contre J. Vigier oui. Si aucun député ne s'était rendu sur place, pour se rendre compte de la situation, que n'aurait-on pas entendu ! Critiquer, mais ça ne vous fatigue pas de chercher des défauts à tout ?
hm 05/03/2025 - 23h03: Les sinistrés doivent en avoir marre de voir défiler tous ces politiques en basquettes blanches et que rien ne se passe!. La Grande France veut s'occuper des problèmes d'autres pays et n'est pas capable de gérer correctement ses territoires et ses départements d'outre mer qui sont des territoires de misères. En 1976, j'ai été détaché à
DJIBOUTI pendant 4 mois, juste avant l'indépendance, j'ai eu honte de la France, d'être français, étant témoin de la misère, de l'état lamentable des infractructures et des missions qu'on nous demandait de faitre étant gendarme. Ils ont viré la France et ils ont eu raison.
Une visite pourquoi faire? Président, 1er ministre, tartempion...que des capitaines constat. On sait que l'île a été ravagée, dégâts qui se rajoutent aux problématiques déjà existantes.
Qui gère les DOM TOM c'est pas Don Manuel Valls?
Mais qu'est - il allé faire dans cette (galère) île ?Le malin ?L'important?